Pedro Méndez Vigo
Garanties de la nation espagnole
Paris, 1835
Présenté par Florencia Peyrou
Traduit par Alexandre Frondizi
Présentation
Les premiers écrits explicitement républicains sont apparus vers 1840 en Espagne. Issus des rangs du libéralisme avancé, leurs auteurs étaient majoritairement journalistes, avocats, médecins ou membres d’autres professions libérales appartenant aux secteurs qui défendaient l’héritage de la Constitution de 1812 et, notamment, l’élargissement du droit de vote et la limitation des compétences de la monarchie. Rédigée, faut-il le rappeler, dans un contexte de vacance de pouvoir monarchique après la double abdication de Charles IV et Ferdinand VII à Bayonne, cette constitution exprimait une vraie méfiance à l’égard de la Couronne : le roi, conçu comme chef supérieur de la nation et soumis à sa volonté, voyait sa fonction législative limitée à un pouvoir de veto suspensif et sa fonction exécutive encadrée par les règles approuvées par les Cortès. En mettant en place un suffrage indirect « universel » qui, au nom de l’utilité, la capacité ou l’autonomie individuelle, excluait néanmoins femmes, domestiques et vagabonds, elle enfanta un système politique fortement participatif et inclusif. Ce système électoral conciliait, comme dans la France révolutionnaire, l’« universalité » de la citoyenneté avec un faible pouvoir de décision, et l’appartenance à la nation et la légitimation du pouvoir politique avec un exercice restreint de la souveraineté et de la délibération individuelle. En offrant l’égalité devant la loi à tous les Espagnols et le statut de citoyen à la quasi-totalité des hommes majeurs résidant en Espagne, la Constitution de Cadix avait donc révolutionné l’ordre social de l’Ancien Régime.
Toutefois, à partir de 1830, la plupart des libéraux espagnols s’éloignèrent des principes de la Constitution de 1812 et devinrent des doctrinaires attachés au suffrage censitaire et à l’idée d’une souveraineté partagée entre le Roi et les Cortès. Ce changement s’inscrivait dans le contexte plus large des reconfigurations du libéralisme européen, marquées tant par le refus du jusnaturalisme révolutionnaire que par la volonté de concilier tradition et modernité, ordre et progrès. C’est ce changement que concrétisèrent les Chartes constitutionnelles portugaise de 1826 et française de 1830 ainsi que la Constitution belge de 1831. Alors que la liberté était, en raison d’une conception de la citoyenneté comme droit naturel, liée chez les premiers libéraux à la participation politique et au contrôle constant des autorités, elle apparaissait désormais chez les libéraux des années 1830, qui arrimaient les droits politiques à la propriété, comme garantie de l’ordre et des droits civils.
En Espagne, ce nouveau libéralisme se manifesta dans la Constitution de 1837. Élaborée ensemble par des libéraux modérés et par des libéraux progressistes, elle affermissait l’autorité monarchique, établissait un système bicaméral et instaurait un suffrage censitaire restreint à 2.2 % de la population. De couleur exclusivement modérée, la Constitution de 1845 fortifierait encore davantage les pouvoirs de la Couronne et la nature conservatrice du Sénat et réduirait le droit de vote à 0.8 % de la population. Seuls les plus avancés ou radicaux restèrent en marge de ce tournant conservateur du libéralisme qui, par ailleurs, profitait du soutien de la Couronne. Face à cela, nombre d’entre eux évoluèrent à partir de 1833 et, surtout, de 1835 vers le républicanisme démocratique auquel d’aucuns étaient sensibilisés par les discours démocratiques, républicains et socialistes croisés en exil. À leurs yeux, la monarchie non seulement perdit toute capacité d’agir comme pouvoir modérateur et de libéraliser le système politique, mais commença même à représenter l’incarnation des anciens privilèges qu’il fallait combattre.
Le document ici traduit, publié à Paris en mars 1835, est sans doute l’un de ceux qui illustrent le mieux ce processus de radicalisation de certains libéraux espagnols face au tournant conservateur de la majorité de leurs anciens camarades. L’itinéraire de son auteur incarne parfaitement ce passage du libéralisme avancé au républicanisme. Maréchal de camp exilé depuis 1823, Pedro Méndez Vigo était né en 1783 au sein d’une famille de la petite noblesse d’Oviedo, puis avait combattu pendant la Guerre d’Indépendance contre les troupes napoléoniennes qui l’avaient blessé lors de la bataille de Toulouse en 1814. Son appartenance au libéralisme gaditan avait freiné sa carrière militaire, puisqu’il avait dû attendre l’année 1817 pour être nommé colonel du régiment d’Oviedo. Gouverneur de La Corogne pendant le Triennat libéral (1820-1823), l’expédition des Cent Mille Fils de Saint Louis l’avait en 1823 arrêté à Mahíde, retenu à Limoges comme prisonnier de guerre, puis contraint à l’exil londonien pendant qu’un tribunal exceptionnel le condamnait à la peine de mort à cause de la noyade d’absolutistes lors du siège de La Corogne. Comme, à peine installé à Paris, il prit en 1830 part à l’expédition menée en Aragon pour rétablir la liberté en Espagne, Pedro Méndez Vigo fut deux ans plus tard exclu de l’amnistie des exilés, puis même de l’amnistie de 1834 qui maintenait les confiscations et les peines de mort dictées en 1823 par les tribunaux exceptionnels.
Les Garantías de la nación española, incluses dans España y América en progreso, livre que Pedro Méndez Vigo publia avec un certain A. P. chez l’imprimeur parisien H. Fournier, installé au 14 rue de Seine, expriment la critique naissante de la monarchie espagnole. Elles posent, sur les bases du constitutionnalisme gaditan, les fondements du républicanisme. Elles affirment d’emblée, et sans recourir aux théories jusnaturalistes, que la participation aux affaires de la cité garantit à chaque citoyen la liberté et constitue donc un devoir consistant à faire usage de sa raison et de sa force. Contrarier ces attributs naturellement humains, c’est opérer un « crime de lèse-humanité » et tomber au « degré ultime de l’humiliation ». Puisque, sous prétexte de maintien de l’ordre, les monarchies absolutistes et constitutionnelles refusent de garantir la participation populaire, il revient désormais aux peuples de garantir leur sûreté par une loi faite par eux et pour eux. Toutefois, étant donné qu’il résulte impossible que deux millions d’hommes puissent se réunir pour délibérer, l’intervention des peuples passe non pas par la délibération et la discussion des lois, dont doivent s’occuper leurs représentants élus, mais par la surveillance et la sanction de ces lois.
Le texte dénonce également l’hypocrite « égalité devant la loi » dès lors que cette dernière est élaborée par de faux représentants du peuple qui conservent « une première chambre privilégiée, une seconde de monopole électoral et d’innombrables titres et privilèges dont le seul but est d’élever certaines personnes ou classes au-dessus du citoyen ordinaire et d’avilir le statut du simple citoyen ». Il ne suffit donc pas de déclarer l’égalité de tous les citoyens devant la loi. Il faut garantir cette égalité. Le nouvel ordre social qui substitue les citoyens aux ordres et aux corporations réclame la disparition de toute forme de privilège et de l’ensemble des distinctions et hiérarchies sociales héritées de l’Ancien Régime : la citoyenneté doit être forcément égalitaire et émancipatrice.
Quant à la liberté, les Garanties la définissent comme « le libre exercice des facultés de l’homme dans le cadre de la loi ». Cette définition prend cependant tout son sens si et seulement si « la loi s’élabore et s’exécute sous l’intervention et la surveillance du peuple ou, en d’autres termes, de la société en masse ». Aller contre ce principe au nom de la « souveraineté de la raison » est d’autant plus illégitime que ce prétexte n’est que « la confiscation de la raison en faveur des riches et des titrés ». Il n’y a qu’un « gouvernement populaire, c’est-à-dire un gouvernement dans lequel interviennent les masses », qui peut assurer la vraie liberté et garantir les droits des citoyens. L’égalité ne peut résulter que de la disparition de groupes privilégiés et de chambres fondées sur « l’insolent principe qu’il puisse y avoir d’autres intérêts à représenter que ceux du peuple en commun ou une classe distincte de la masse des citoyens ». Il faut par conséquent étendre largement le droit de vote et revenir à une seule chambre de représentants, la « chambre du peuple ».
Cependant, une constitution véritablement faite par et pour le peuple doit garantir d’autres institutions et principes nécessaires à la mise en place d’un régime de liberté et d’égalité. Parmi les premières, un rôle politique fondamental revient à la garde nationale, formée par « tous les hommes domiciliés et ayant un mode de vie connu », tous électeurs éligibles aux fonctions politiques et admissibles aux emplois publics. Parmi les seconds, la Constitution doit garantir l’abolition des privilèges et des distinctions sociales, mais aussi assurer la propriété, le bien-être moral et matériel de tous les individus, les absolues libertés de conscience, de presse, de résidence et d’association, et le droit à la révolution contre un pouvoir tyrannique.
Enfin, concernant la forme de gouvernement, Pedro Méndez Vigo appelle la monarchie à se sacrifier elle-même et à se résigner à une « transition forcée vers le régime populaire et républicain », défini comme le régime qui « rassemble la force nécessaire avec la sobriété [des dépenses publiques] et la majeure liberté possible pour les individus ». Si le régime monarchique apparaît déjà incompatible avec une bonne constitution, la transition vers un ordre républicain s’avère délicate et doit alors passer d’abord par le rétablissement de la Constitution de 1812, jugée certes insuffisante pour assurer les « principes contenus dans la loi du peuple » mais qui, « en déclarant la souveraineté du peuple et le droit de révision, elle inclut virtuellement toutes les transformations que rendrait indispensables le progrès des lumières ». Des institutions tutélaires doivent compléter cette constitution monarchique afin de protéger les droits populaires contre l’ingérence de la Couronne : les associations patriotiques, un Sénat conservateur des institutions politiques et le système fédéral. Les premières sont un vecteur pour l’exercice réel de la souveraineté, entendue comme surveillance des affaires publiques et sanction des actes de gouvernement, d’une part, et comme forme spontanée d’un agir politique impulsant et soutenant l’action des délégués gouvernementaux, d’autre part. Le second, « placé à une certaine distance des événements », doit surveiller l’état général de la nation et le respect la constitution et, si nécessaire, doit pouvoir déclarer « la patrie en danger ».
Fondé sur « l’égalité politique entre les états fédérés », le fédéralisme présente plusieurs avantages. Outre qu’il serait en mesure d’assurer « la réunion des deux peuples péninsulaires sous un seul gouvernement », à savoir l’éventuelle union avec le Portugal, il éliminerait « ce despotisme impertinent » consistant à imposer à toutes les localités un seul modèle administratif, d’une part, et ranimerait politiquement et économiquement des provinces pouvant, en cas d’attentat contre la liberté à Madrid, jouer le rôle de contre-pouvoir, d’autre part. Pour faire naître cette fédération, il faut autoriser les Députations Provinciales établies par la Constitution de 1812 à se réunir régulièrement en Assemblées territoriales « pour traiter les affaires qui présentent un intérêt commun ».
Face à l’esclavage du gouvernement monarchique dont le caractère héréditaire représente déjà un privilège rendant impossible un gouvernement économe et responsable, les Garanties de la nation espagnole préconisent donc en 1835 un gouvernement démocratique et fédéral fondé sur la participation active et vigilante des citoyens et sur une Constitution de 1812 enrichie d’institutions protectrices de la liberté et propices à l’amour de patrie. De retour en Espagne où, en 1837, il participe à la guerre carliste en tant que capitaine général de Castille-la-Vieille et, en 1839, il se fait élire député de Séville, Pedro Méndez Vigo assume complètement son républicanisme. Au tournant des années 1830 et 1840, il fait partie non seulement du nombre croissant d’écrivains espagnols qui défendent ouvertement le régime républicain, mais aussi de ceux qui œuvrent à la formation d’un mouvement politique républicain. Membre de la Junte centrale républicaine créée pour structurer le « parti » républicain, il est avec Patricio Olavarría et Manuel García Uzal l’un des trois premiers députés officiellement républicains entre 1841 et 1843, année de son décès à Almería.
Document
Pourquoi les peuples sont-ils asservis ?
Parce qu’ils ont cessé de faire usage de leur raison et de leur force.
Abdiquer sa raison et ne pas résister à la tyrannie est un crime de lèse-humanité. Exercer les actes par lesquels le peuple manifeste son intervention dans les affaires publiques et empêche la confiscation de celles-ci par une oligarchie privilégiée n’est par conséquent pas un droit, mais un devoir. Quémander à un gouvernement la permission d’exercer ces droits est la plus grave des humiliations. Le gouvernement tyran qui refuse ou, ne daignant pas même y répondre, méprise cette pétition ne fait que réagir à la petitesse des requérants. C’est des coups de bâton qui s’abattent sur des eunuques qui ne font que manifester des désirs propres aux hommes.
Il ne fait pas de doute que le gouvernement est institué pour assurer le maintien de l’ordre. Mais la néfaste concentration du pouvoir sur un seul homme a répandu dans les peuples modernes une idée aussi fausse que funeste : l’idée que cet homme incarne l’essence du gouvernement et qu’il ne peut y avoir d’ordre sans son influence suprême et modératrice de tout le reste. Les gouvernements constitutionnels ont reproduit cette idée et, pour ne pas laisser de doute, ils ont clairement déclaré que leur principe est la résistance à l’intervention populaire[1].
C’est ainsi que s’est effondré le dernier étendard des mensonges monarco-constitutionnels. C’est ainsi que s’est effondrée l’illusion d’une ligue de princes constitutionnels opposée aux princes absolutistes. Il est désormais clair qu’il n’y d’autre ligue que celle des princes contre les peuples. Les constitutions existent non pas grâce, mais en dépit des princes. Perverties dans leur essence, profanées par l’acceptation d’un pouvoir contraire à elles-mêmes, les constitutions ne peuvent plus faire office de palladium pour les peuples. Ces derniers doivent dorénavant chercher leur sécurité dans une loi du peuple, une loi faite par le peuple et pour le peuple, une loi qui ne peut contenir des principes hostiles au peuple.
Deux millions d’hommes aptes à délibérer ne peuvent certes pas participer au forum pour discuter de l’attribution des fonctions du gouvernement. Mais, libérée du joug de la superstition, la générosité naturelle des hommes fera battre leur cœur aux cris de liberté et de fraternité, accueillir avec liesse les lois qui les assureront, et briser avec horreur les chaînes qu’on voudrait, au nom de l’ordre, leur imposer. Leur abrutissement par le fanatisme n’est pas un motif pour les abandonner au bon vouloir des loups rapaces qui se ruent triomphalement sur eux pour les exploiter. Le genre humain forme une famille solidaire et les progrès de la raison générale compensent les défauts des localités. C’est précisément à ce moment-là que le peuple a besoin d’hommes dédiés à son bien et qui, heureux de l’intensification de ses lumières et expériences, prennent sa défense et soient prêts à se sacrifier pour lui sur l’échafaud. Le sang des martyrs fait fructifier l’arbre de la liberté et fait retomber la malédiction sur les têtes des bourreaux des peuples. L’œuvre des martyrs deviendra la propriété du peuple et la loi sera faite non seulement pour le peuple mais aussi par le peuple. Sophistes, oserez-vous nier cette vérité ?
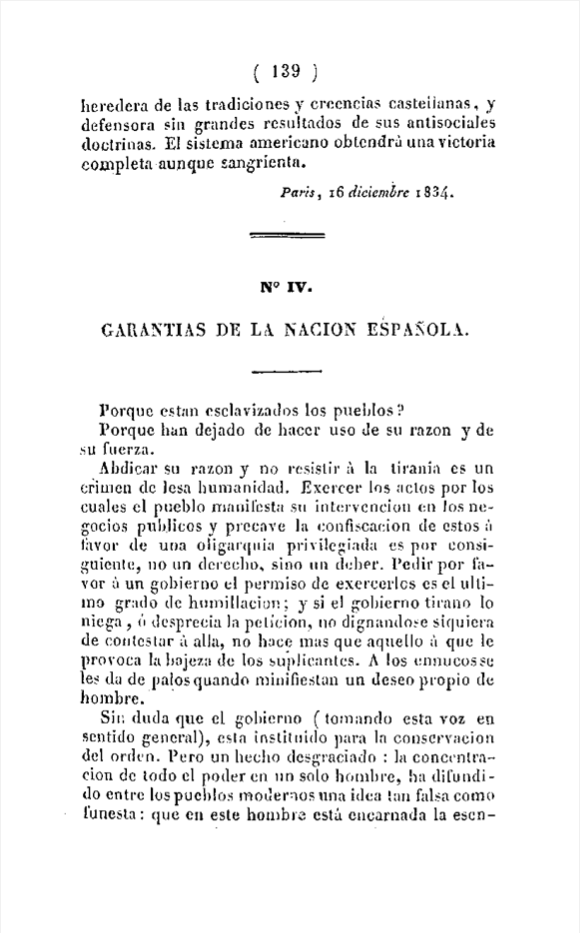
Établir la loi du peuple, c’est proclamer ces principes généraux et leurs conditions locales en quelques lignes simples et compréhensibles par tous. L’organisation plus compliquée des détails sera l’œuvre des élus du peuple et formera précisément les privilèges nationaux ou ce que l’on appelle aujourd’hui la constitution.
L’expérience a enseigné aux hommes les plus humbles ce qui ne pouvait auparavant être envisagé, pas même par ceux qui s’étaient spécialement dédiés à l’observation des gouvernements et qui souhaitaient sincèrement communiquer leurs découvertes.
L’expérience nous a enseigné que la reconnaissance théorique de la souveraineté du peuple ne suffit pas. Celle-ci est légalement reconnue en Angleterre et en France, et elle l’était en Espagne par la constitution de l’an XII. Or, voyez comment vont ces nations. D’aucuns définissent aujourd’hui la souveraineté comme « le droit allié à la force » et jugent les institutions en fonction de leur congruence avec ce double fondement. L’expérience nous a enseigné à quel point il est funeste de tout attendre d’un gouvernement qui est entre les mains non pas du peuple, mais d’un homme – le roi – ou de quelques oligarques – ministres, procureurs, etc. – dont les nominations et responsabilités ne tiennent aucunement compte de l’avis du peuple. Ces oligarques et leur chef, le roi, centralisent tout le pouvoir entre leurs mains et affirment que telle est la condition de l’ordre. Mais cet ordre, il faut bien le comprendre, n’est en réalité qu’un ordre au service de leur domination. Car il existe des peuples qui se gouvernent par l’ordre populaire et qui sont bien plus heureux. Sachez donc que quand ces hommes parlent d’ordre, ils ne se réfèrent qu’à l’ordre monarchique, c’est-à-dire au privilège d’opprimer le peuple pour éviter son intervention qu’ils nomment anarchie. Sachez aussi que lorsqu’ils parlent de la loi, il s’agit toujours de la loi faite par eux. En disant « devant la loi » sans préciser qui fait la loi ni qui l’exécute, ils détruisent la liberté et l’égalité. Sans cette duperie, il serait évident qu’il s’agit de la loi des loups contre les brebis. Ce n’est qu’avec une argumentation aussi inique que les prétendus représentants du peuple ont pu dire que l’égalité n’empêche pas qu’il y ait une première chambre privilégiée, une seconde de monopole électoral et d’innombrables titres et privilèges dont le seul but est d’élever certaines personnes ou classes au-dessus du citoyen ordinaire et d’avilir le statut du simple citoyen sans plus de cérémonie[2].
L’expérience nous a enseigné qu’il est impossible de maintenir et de garder l’ordre, le vrai ordre, sous un gouvernement immuable, irresponsable et s’élevant ostensiblement au-dessus de tous les citoyens qu’il séduit, corrompt ou intimide avec son faste, son impunité et ses immenses ressources. Les peuples sont désormais convaincus que leur sang coule en vain et qu’ils exposent pour rien leur poitrine à la baïonnette des satellites du despotisme si leur victoire ne supprime pas la cause qui a rendu nécessaires les révolutions et qui n’est autre que l’existence d’un gouvernement qui, en niant la dépendance au peuple, se prétend légitime ou semi-légitime au sens d’héréditaire, inviolable et irresponsable. Lafayette a nié avoir dit, en présentant un roi révolutionnaire au peuple, « celle-ci est la meilleure des républiques ». Mais, s’il l’a dit, il a alors dit la plus grande des absurdités.
L’expérience nous a enseigné que tous ces tyrans appelés rois ont formé une ligue qui étouffe toutes les révolutions populaires en brandissant la crainte d’une invasion. Car, en entraînant tel Attila leurs hordes sauvages par millions contre ce malheureux peuple de France et en fomentant en même temps les conspirations et rebellions serviles qui brisaient son sein, ils ont réussi à lui imposer les efforts que seul fait au bord du précipice un homme désespéré, les tyrans croient que le souvenir de ces calamités, dont ils sont coupables, dissuadera à jamais les peuples de réitérer une telle tentative et se flattent même de penser que, soumis à l’alternative « esclavage ou guerre », les peuples seront toujours assez misérables pour préférer le premier. Mais cette illusion, terrible seulement aux yeux de ceux qui n’ont pas eu le courage de la regarder sereinement, tombera maintenant que les peuples qui s’étaient laissé guider et halluciner par les égoïstes oligarques – lesquels sont en effet suffisamment vils pour mettre la paix au-dessus de toutes les bassesses et de toutes les humiliations – n’écouteront plus cette voix corrompue. Alors, depuis le champ de bataille où ils auront renversé les despotes qui les oppriment, ils se rendront à la frontière par où pourraient arriver les despotes alliés et, suivant la loi de la fraternité, ils viendront en aide au peuple voisin qui, animé par leur présence d’hommes libres, secouerait ses chaînes et leur réclamerait secours.
L’expérience nous a enseigné que les bases de toute société ordonnée – la liberté, l’égalité et la fraternité – sont l’objet d’attaques constantes de la part des gouvernements séparés des peuples ; qu’on a tenté de les préserver en insérant des définitions juridiques dans les constitutions ; qu’aucune de ces définitions n’a pu échapper à la sinistre interprétation des sophistes au pouvoir ; mais qu’il est aisé de donner une définition juridique satisfaisante de ces voix, dont le sens est gravé dans le cœur de l’homme, et d’assurer son application pratique à condition que l’élaboration et l’exécution des lois soient soumises à la sauvegarde non pas théorique, mais effective de la souveraineté populaire. C’est le seul moyen d’éviter que l’on impose aux hommes une restriction de leurs facultés et qu’il n’y ait pas de manquement à l’obligation solidaire de tous les hommes d’œuvrer pour le progrès général. Il ne suffit par exemple pas de dire que la liberté est le libre exercice des facultés de l’homme dans le cadre de la loi puisque, comme la plupart des lois qui nous gouvernent, cette loi peut être mauvaise. Cette définition devient pourtant complètement satisfaisante quand la loi s’élabore et s’exécute sous l’intervention et la surveillance du peuple ou, en d’autres termes, de la société en masse. Il ne suffit pas de dire que la raison doit présider à l’élaboration et à l’exécution des lois, car qui est dépositaire de la raison ? C’est encore l’expérience qui nous a enseigné que ce prétexte de la souveraineté de la raison n’est autre que la confiscation de la raison en faveur des riches et des titrés, c’est-à-dire des hommes qui, loin de se montrer les plus indépendants, ont toujours été les plus égoïstes, serviles et vénaux. Au vu de gouvernements comme ceux de Walpole, Villèle, Perrier, Thiers ou Martinez de la Rosa, il ne fait aucun doute qu’il n’y a de cœur que dans les masses[3], qu’il n’y a qu’un gouvernement populaire, c’est-à-dire un gouvernement auquel les masses infusent l’esprit, qui peut faire des lois qui ne s’occupent pas piétiner les libertés et de flatter les trônes, mais de réparer les libertés et de respecter scrupuleusement les droits du citoyen. Ce n’est qu’alors que l’égalité ne se limitera plus, comme dans le langage trompeur de la monarchie, à la perspective de devenir membre des classes privilégiées, mais qu’il y aura une véritable égalité puisqu’il n’y aura plus de classes privilégiées ni donc personne pour conserver les privilèges et favoriser le pouvoir qui est aujourd’hui le point culminant de tous les privilèges. Il n’y aura pas une première chambre, basée sur l’insolent principe qu’il puisse y avoir d’autres intérêts à représenter que ceux du peuple en commun ou une classe distincte de la masse des citoyens. Il n’y aura pas non plus une seconde chambre, composée d’autres personnes privilégiées par la fortune, mais dépourvues des vrais mérites d’un être rationnel, à savoir les lumières, la probité et le caractère. Il n’y aura pas une lignée ou une caste qui, craignant de perdre ses privilèges, sente le besoin de « tempérer l’effervescence populaire », expression favorite des hypocrites. Il n’y aura donc qu’une chambre, la chambre du peuple, et une condition, celle de l’aptitude reconnue par le peuple. Et, une fois que le peuple aura reconnu cette aptitude et que la constitution lui aura garanti de pouvoir intervenir dans les cas et la forme nécessaires au bien public, on ne lui attribuera plus cette jacassante effervescence qui n’existe que là où l’injustice et les vilenies irritent les âmes.
Enfin, l’expérience nous a enseigné combien sont fausses toutes les promesses des gouvernements qui ne sont pas fondés sur les principes pratiques d’une entière liberté. Pour répondre à ces promesses d’une liberté progressive, il faudrait que la monarchie se renie elle-même et se résigne à cette transition forcée vers le régime populaire et républicain ; mais cette abnégation n’est pas dans la nature de l’homme et encore moins dans celle de ceux qui veulent conserver pour eux et pour leur famille des avantages et des prérogatives hautement disproportionnés par rapport au sort commun des citoyens. Toute innovation qui les priverait d’un quelconque privilège leur semblera toujours prématurée ; leur position même, en leur faisant toujours craindre l’imminence du moment fatidique, les conduit à employer des moyens violents pour conserver l’ordre dont ils se croient ou, du moins, se revendiquent les premiers garants. Malheureuse est la révolution qui ne profite pas de l’instant victorieux pour arracher à la racine les abus qui lui sont contraires et qui, brièvement dissimulés, ressurgissent plus forts et plus dangereux pour la société. La force des choses est telle que les gouvernements sont entraînés au-delà de ce qu’ils pensent et se retrouvent après quelques années dans une position entièrement contraire à celle qu’ils s’étaient sans doute promise. Qu’est-il arrivé à la monarchie citoyenne d’un royaume voisin ? Au lieu d’attirer à elle tous les intérêts et d’occuper une position éminente dans la politique européenne, elle s’est successivement mise à dos toutes les opinions, y compris celles si modérées du Constitutionnel et du Temps, et elle s’est radicalement isolée à l’extérieur, y compris par rapport à ceux qui semblaient ses alliés naturels et qui, si les peuples le leur permettent, sont aujourd’hui sur le point de passer dans le camp adverse. Qu’est-il arrivé aux whigs d’Angleterre ? Ils ont été contraints de céder la place aux sectaires de l’Ancien Régime et n’ont désormais d’espoir que dans le mouvement populaire que la plupart d’entre eux craignent tant. Enfin, quel a été l’édifice érigé sur « les ciments » du maudit Statut royal ? Loin de perfectionner quoi que ce soit et d’élargir les libertés publiques, le gouvernement s’est, avec un succès qui sera éternellement reproché aux procureurs de 1834, minutieusement opposé à tout ce qui aurait été ne serait-ce que d’un iota en désaccord non pas avec le Statut royal, qui ne détermine quasiment rien, mais avec le règlement intérieur des Cortès que les ministres ont forgé avec une insolence sans précédent parmi les fastes constitutionnels, en y insérant malicieusement de solides obstacles à tout progrès, règlement auquel les mal nommés représentants de la nation se sont soumis avec une ignominie que l’on ne trouverait pas même dans les chambres de l’Allemagne opprimée.
Ce sont les applications politiques plus générales qui résultent de ces antécédents, et qui sont d’ailleurs accessibles à tout entendement, qui devraient constituer la loi du peuple : un résumé de maximes pratiques qui ne sont pas la constitution, mais qui servent à l’établir et à résoudre les cas douteux, car elles sont la source de tout droit et par conséquent des axiomes sacrés qu’aucune loi ou mesure subalterne ne peut nuancer, modifier, rogner ou abolir. Certaines de ces maximes sont incluses dans les constitutions existantes[4], mais elles ne sont complètes dans aucune de ces constitutions. Elles sont au mieux mentionnées pour sauver les apparences, ces constitutions se réservant les moyens de leur exécution grâce à la clause selon laquelle « une loi spéciale expliquera leur sens et leur application », ou repoussant leur application aux calendes grecques ou encore les annulant avec le fallacieux prétexte de les protéger. Il est vrai qu’en lisant et écoutant les écrits et les préambules législatifs des gouvernements et des parlements corrompus on répugne à donner du crédit à nos propres sens et l’on se demande ce qui est le plus surprenant entre la conception méprisable que les gouvernements ont de peuples qu’ils osent tromper avec des mensonges évidents et la stupidité et l’indifférence des hommes qui acceptent comme garanties de liberté ces lois d’oppression. Mais, puisque nous ne concevons pas la loi séparément du but et du fonctionnement de la législation et que nous croyons que la loi dictée sous l’inspiration des masses sociales serait fort différente de la loi élaborée sous la funeste influence du trône, il nous semble que la loi du peuple, la loi faite par le peuple et pour le peuple, devrait contenir les vérités suivantes :
1. Le peuple se déclare souverain et, par cette déclaration, entend qu’il est le seul à avoir le droit de constituer et de modifier les institutions sociales.
2. Le peuple, possédant le droit et la force, place son droit sous la protection de la force en se constituant en garde nationale.
Tous les hommes domiciliés et ayant un mode de vie connu sont gardes nationaux.
3. Le peuple se déclare un et indivisible et n’admet aucune division de classe.
Tous les gardes nationaux sont électeurs et éligibles aux fonctions publiques d’élection populaire.
Tous les gardes nationaux sont, selon leurs aptitudes, éligibles aux emplois dont la nomination dépend des pouvoirs publics.
4. Le peuple reconnaît la fraternité entre tous les individus et l’obligation de leur procurer leur bien-être moral et matériel.
5. Le peuple reconnaît la fraternité entre tous les hommes et appliquera ce principe à ses relations avec les autres peuples.
6. Le peuple reconnaît la liberté de conscience et sépare totalement le temporel du spirituel.
7. Le peuple, afin que l’on ne remette pas en cause sa bonne foi, déclare qu’il ne reconnaîtra aucune constitution qui ne lui assurera pas les dispositions positives suivantes :
- L’indéfectible liberté de presse ;
- La liberté individuelle et de résidence ;
- La liberté d’association ;
- La propriété constituée par la loi.
8. Le peuple proteste contre les futurs tyrans et contre toute prétention fondée sur la contrainte. Le peuple délègue expressément à tous les patriotes et à chacun en particulier le droit de repousser la tyrannie par la force et de poursuivre le tyran comme s’étant mis hors-la-loi.
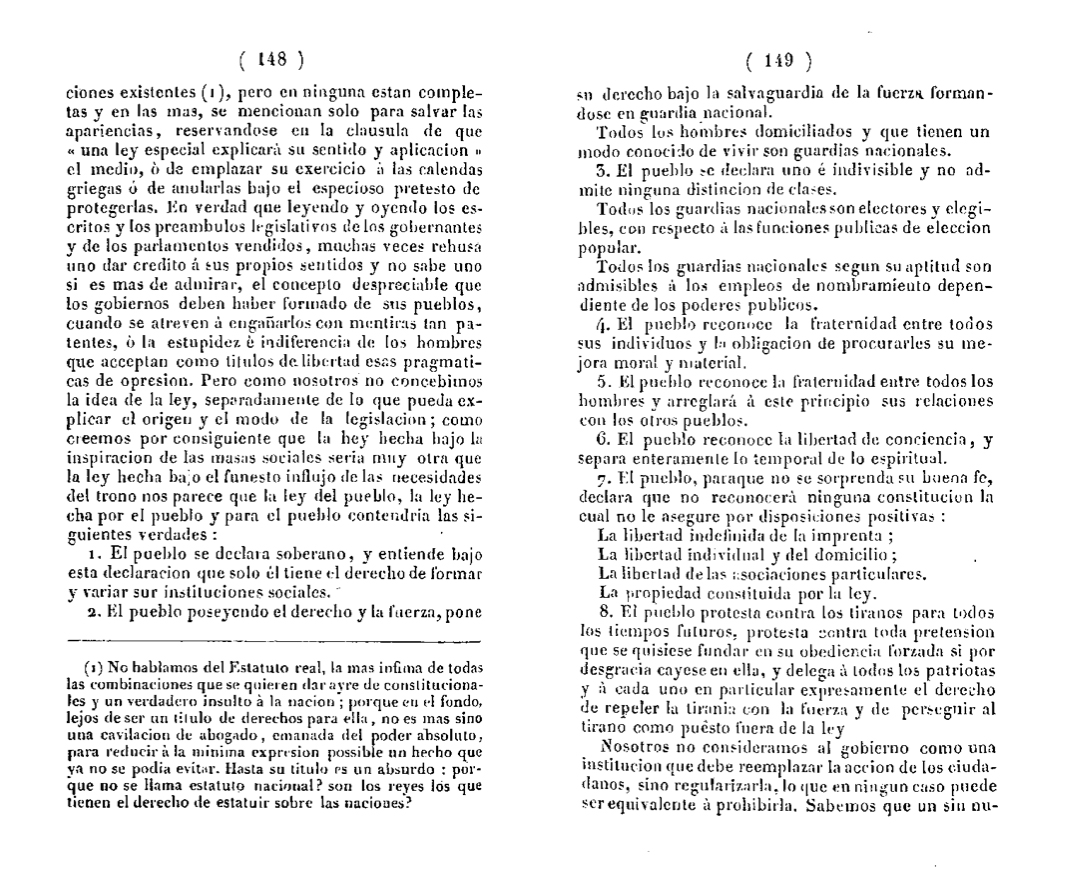
Nous considérons le gouvernement comme une institution qui doit non pas remplacer, mais réguler l’action des citoyens et sans, en aucun cas, pouvoir l’interdire. Nous savons que, par ignorance ou égoïsme, un nombre incalculable de soumis observent l’exercice des droits mentionnés comme le comble de l’anarchie et le rejettent avec l’éternel et insipide refrain de l’impossible mise en pratique. Nous savons pourtant aussi que la mise en pratique existe non seulement dans les cerveaux que les soumis prétendent malades, mais surtout dans une grande et puissante nation qui trouve une source inépuisable de jouissances morales et matérielles dans cette pratique pacifiquement menée à un degré que l’on ne soupçonne même pas. Et, si l’on nous objecte que cette nation est une république, nous tirerons la conclusion qu’il faut non pas sacrifier les libertés auxquelles aspire tout homme et conserver des formes vieilles et vicieuses qui n’intéressent que ceux qui en tirent le plus grand profit, mais qu’il faut, au contraire, rejeter ces formes pour en introduire d’autres justement fondées sur l’exercice des droits populaires. Si l’on demande tout au gouvernement et l’on attend tout de lui, que les citoyens se résignent alors à régresser à la classe d’automates et à céder au gouvernement toute la force sans laquelle il ne pourrait tenter de faire bien ou mal tant de choses qu’on exige de lui. C’est le système des poltrons qui considèrent les constitutions inopportunes et n’aspirent qu’à un gouvernement paternel où, comme en Autriche, Russie ou Prusse, ce père, roi ou empereur, les dévore comme Saturne ses enfants. De notre côté, puisque nous avons un concept plus noble du destin de l’homme, nous souhaiterions que les citoyens apprennent comme un catéchisme les articles de la loi du peuple et qu’ils se laissent pénétrer de son esprit, qui les élèvera à la dignité d’hommes et fera en sorte que le gouvernement avance à leur côté et corresponde à leurs souhaits. Qu’il soit clair que ces libertés publiques constituent une chaîne de laquelle on ne peut soustraire un maillon sans que toute la chaîne tombe en morceaux. Mais qu’il soit également clair qu’il ne servira à rien d’établir des institutions politiques si l’esprit de la nation ne leur attribue pas l’autorité et le poids indispensables à sa stabilité. Combien de temps ont duré les tribunats et les sénats conservateurs institués par l’empereur Napoléon ?[5] Et, à l’inverse, pourquoi les institutions les plus ridicules durent-elles autant, si ce n’est à cause de l’ignorance et de la dépression dans lesquelles a sombré le peuple ? Quelle nation dotée du sentiment naturel d’égalité pourra souffrir longtemps une chambre de Próceres dont rien que le nom est une insulte pour le peuple ? Puisque le titre de Próceres renvoie à ceux qui égorgent et sont à la tête des autres. Ce titre, qui serait dangereux ou infondé même s’il était prononcé par le peuple, atteint les cimes de l’absurdité quand il est accordé par le gouvernement pour récompenser la servilité et l’incapacité. L’Espagne a connu des próceres quand il y avait une noblesse féodale, au sein de laquelle les próceres étaient les familles les plus anciennes et prestigieuses. Mais pourquoi, après la disparition politique et sociale du féodalisme, vouloir rétablir une supériorité qui n’a plus de base ni lieu d’être et qui, quoique grotesquement recouverte du manteau d’hermine et armée des bâtons isabelins, sera difficilement manifeste avec les 60 000 réales de rente et la nomination gouvernementale. Quel peut être l’objet d’une telle institution ? Le sage Marchena l’a dit autrefois : voulez-vous un régime populaire ? Instituez alors une chambre de représentants. Préférez-vous une monarchie ? Instituez alors une chambre aristocratique. S’il ne s’agissait en effet que d’introduire deux degrés de discussion, dont on ne voit pas l’utilité pour un pays où ne demeurerait qu’un intérêt unique, celui du peuple, la chambre des Pairs ou des Próceres ou d’un quelconque autre nom ne se verrait pas donner ces airs de hiérarchie distinguée proche du trône qui, semble-t-il, s’accompagnent obligatoirement d’une résistance servile[6] à toute innovation qui puisse conduire la société à se libérer progressivement de l’étouffant poids des dynasties[7]. Peut-il exister un exemple plus effrayant des implications de l’absence de lumières et d’esprit libéral chez le peuple que celui que nous font voir les trop nombreux sectaires apostoliques ? Supposons un instant que l’Inquisition ne soit qu’un prétexte, même si elle reste hélas pour beaucoup l’objet d’un vrai désir. Peut-on croire qu’au 19e siècle les hommes puissent encore invoquer un tel prétexte pour s’entretuer ? Ajoutons, puisque nous ne sommes pas de ceux qui disent des demi-vérités : si l’objet de la dispute est une personne royale, existe-t-il un roi, se nomme-t-il Jean ou Pierre, qui puisse justifier le sang qui est en train d’être versé avec une telle férocité ? Si le peuple n’était pas absorbé par d’anciennes préoccupations dans lesquelles on veut le maintenir chaque fois plus, sacrifierait-il ses enfants et ses biens pour le prestige de quelques noms qui représentent tout sauf les principes de liberté ? Ne lui viendrait-il pas alors à l’esprit d’écarter tout prétendant et de se limiter à examiner ce qu’il revient de faire pour garantir au citoyen ses vrais intérêts qui, à vrai dire, n’ont aucun besoin de ce saint ni de l’autre ?
Peut-il y avoir un peuple moyennement instruit qui ne comprenne pas ces quelques lignes que nous avons établies comme loi du peuple ? Quel citoyen des États-Unis ne les connaît ni ne les applique ? Même dans des pays comme l’Angleterre où ils ne sont que partiellement mis en pratique, les citoyens profitent des droits acquis non par subversion, mais pour le bien public. Or, si le peuple, étant privé des lumières qui favorisent l’entendement et de la pratique qui forme les coutumes, ne peut pas le comprendre, il doit alors renoncer à une constitution politique. Car c’est dans ces quelques lignes que sont tracés le fondement et le sens des institutions publiques qui, en retour, n’ont pas une valeur propre et indépendante des droits qu’elles se doivent d’assurer. C’est pour cela que nous appelons « loi du peuple » ce recueil de maximes qui doit servir au peuple de critère pour apprécier et modifier ses institutions. À quoi bon se constituer en garde nationale si le peuple ne connaît pas les principes qui le guideront dans ses délibérations et élections ? À quoi bon déclarer sa souveraineté s’il ne sait pas l’exercer ? À quoi bon se constituer en république si celle-ci n’exprime pas un objet social ? Les républicains ne soutiennent pas leur gouvernement parce qu’il s’appelle république, mais parce que ce gouvernement rassemble la force nécessaire avec la sobriété et la majeure liberté possible pour les individus[8]. Mais les monarchies appliquent un système diamétralement opposé. Que tout périsse pourvu que le trône soit défendu ! Telle est la maxime des Ferdinands et des Philippes qui en même temps qu’ils ont enraciné dans la nation une préférence monarchique aveugle – car elle ne s’appuie sur la comparaison avec aucun autre modèle de gouvernement – l’ont enfoncée dans un abîme de dégradation duquel elle ne se dégagera pas tant qu’elle n’aura pas systématiquement et librement analysé ses institutions. Il est une circonstance qui trompe beaucoup de monde : l’Espagne a certes toujours eu des rois, mais leur autorité était limitée autant par le droit que par l’intervention populaire des Cortès. Il ne fait pas de doute que, conjointement à d’autres circonstances, ce type de gouvernement a longtemps permis au pays de prospérer. Personne ne pourra toutefois nier que cet état de fait était fort confus et informe et ne se maintenait que par l’équilibre naturel entre les différentes classes qui divisaient alors la société. Personne ne voudra aujourd’hui revenir au chaos féodal qui renfermait en son sein le germe de sa destruction. Depuis que l’unité nationale a été obtenue par la réunion des couronnes de Castille et d’Aragon et par la conquête de Grenade, il a été nécessaire d’adapter le mouvement intérieur d’une société jusqu’alors davantage régie par les circonstances et les événements que par une connaissance éclairée des institutions politiques. Il serait digne de l’intérêt d’un historien d’expliquer pourquoi la noblesse espagnole, au lieu de suivre l’exemple de la noblesse anglaise, a préparé sa ruine immédiate en choisissant d’imiter la noblesse française, et d’abandonner la cause du peuple. Nous soupçonnons que l’orgueil orthodoxe, en engendrant une espèce de mépris d’un peuple comptant encore des maures et des juifs y a beaucoup contribué et a facilité la soumission du corps aristocratique au joug dégradant de l’inquisition. Quoi qu’il en soit, il est arrivé en Espagne ce qui adviendra dans toutes les monarchies, ce qui est arrivé en France il y a un demi-siècle, ce qui arrive actuellement en Angleterre avec la décadence inévitable de l’aristocratie : la monarchie s’est confrontée au principe populaire et, par malheur, elle l’a vaincu. Les idées de liberté n’ont ressurgi qu’à notre époque, mais notre pays pourra facilement suivre l’ordre naturel des sociétés modernes. Car cet ordre est fondé sur l’unité sociale qui, reconnaissons-le, a été l’œuvre d’un despotisme ayant détruit l’indépendance des classes privilégiées qui, par exemple en Angleterre, représentent encore des obstacles de taille. Reconstruire des existences ayant fait leur temps, apprécier les lois par la valeur qu’elles ont eue à des époques très différentes des nôtres, c’est un anachronisme. Mais rejeter les lois qui sont l’expression de principes applicables à tous les temps et à tous les hommes pour ne ressusciter que celles qu’il faudrait justement modifier si elles étaient encore en vigueur, et appeler cette magouille « rétablissement des lois de la patrie », cela est une pensée aussi absurde que criminelle qui, pourtant, se manifeste sans scrupules et avec la plus grande brutalité dans l’œuvre célèbre des Burgos et des Martinez de la Rosa. Or cette œuvre a reçu l’adhésion d’hommes qui peuvent s’enorgueillir d’avoir participé à l’élaboration ou, du moins, à la défense de la constitution de 1812, d’hommes voués à sa défense en raison de la présence, chez leurs parents et leurs proches, de martyrs de la liberté qui, s’ils pouvaient revenir parmi nous, détourneraient leur regard et, indignés, retourneraient dans leur tombe afin de ne pas être les témoins d’un avilissement si inconcevable[9].
Nous avons déjà suffisamment expliqué ailleurs la raison et le sens de notre adhésion à la constitution de 1812. Elle ne contient certes pas toutes les institutions qui constituent la garantie matérielle des principes contenus dans la loi du peuple. Mais, en déclarant la souveraineté du peuple et le droit de révision, elle inclut virtuellement toutes les transformations que rendrait indispensables le progrès des lumières. Ainsi l’ont compris les Espagnols, qui ont commencé à introduire certaines actions politiques qui paraissaient nécessaires au soutien de la constitution. En 1820, des sociétés patriotiques se sont organisées comme par enchantement dans toute l’Espagne : elles ont entamé une correspondance avec la société centrale madrilène de la Fontana de Oro dont elles se sont montrées disposées à recevoir l’impulsion. Quel immense soutien pour un ministère intelligent et libéral ! Que ces sociétés n’étaient pas dangereuses est mis en évidence par la facilité avec laquelle elles ont été détruites. Si seulement il y avait eu à leur tête des hommes avec l’influence suffisante pour résister au pouvoir de la cour… On n’aurait alors pas dissout l’armée de Riego, on n’aurait pas toléré le malheureux ministère Feliú, on ne serait pas resté aussi intolérablement apathiques face à la sédition armée ou, du moins, on aurait rassemblé les 500 000 libéraux qui se tenaient prêts à prendre les armes. Quelle vie politique différente de celle que nous avons endurée sous le joug infâme de la tromperie, du mensonge, de l’humiliation, de cet avilissement qui a débouché sur dix ans d’une tyrannie dont certains faux Espagnols osent encore se réclamer !
Imaginons un instant quelle issue différente on aurait pu espérer si un magistrat suprême ou sénat conservateur – quel que soit le nom qu’on lui donne – avait surveillé méticuleusement l’origine et la progression du mal qui nous minait, s’il avait proclamé dès que nécessaire la patrie en danger et appelé « aux armes » les citoyens réunis dans des sociétés patriotiques ! Le sort de la nation entière aurait-il été mis en danger par la lâcheté et la traîtrise de ceux qui gouvernaient, pour ne pas dire ceux qui fuyaient la capitale, si le pouvoir centralisé dans des mains perfides ou ineptes n’avait pas dilapidé les ressources qu’il possédait et entravé l’accès aux immenses ressources que les provinces renfermaient ? Ces soixante-dix ou quatre-vingt mille satellites du despotisme qui ont envahi l’Espagne étaient-ils en mesure de vaincre et de conquérir la Galicie, sépulcre des armées des deux maréchaux ? L’Andalousie, avec ses ressources et sa population libérale, s’appuyant sur la position de l’île gaditaine ? Le royaume de Murcie, avec le soutien des bastions de Carthagène et Alicante ? La Catalogne, parsemée de forteresses et capable à tout moment d’affronter à elle seule une guerre sanglante ? Ou d’autres nombreuses localités où l’on disposait de places de guerre et de noyaux de forces libérales armées ? Mais les juntes provinciales ont été dissoutes depuis le début, comme a été dissoute l’armée de Riego et l’ont été les sociétés patriotiques. Et, à la place d’un sénat conservateur, il y a eu une camarilla conspiratrice qui dominait tout, qui trouvait de l’indulgence partout et qui, nous rabaissant misérablement à ses plans constitutionnels, nous préparait en premier lieu un sénat servile dans une chambre de Pairs ou dans un conseil d’État nommé par le Roi.
Si, à la place des timides et ténébreuses intrigues de quelques chefs dépendants du capitaine général de Catalogne, on avait pu former une association patriotique et tenir un débat public, pourrait-on croire que le fameux manifeste de Barcelone fût réduit à des limites si étroites, à des indications si ambiguës et si mesquines, en accouchant d’une souris avec le Statut royal ? Dans les provinces rebelles, les sociétés patriotiques auraient pu soutenir l’opinion libérale en formant un parti capable de contrecarrer les progrès de l’opinion carliste, qui a fini par dominer complètement car il ne lui a été opposé aucune force morale, mais juste une impuissante brutalité. Enfin, même à Madrid, l’opinion étant privée de tout moyen de réaction contre le gouvernement, les hommes à la tête de celui-ci accompliront sans tarder notre mauvais présage : si l’Espagne tombait cent fois dans leurs mains, cent fois elle serait conduite à sa perte[10].
Le fait est que, comme toute constitution monarchique, la constitution de l’an 12 renferme un germe d’hostilité envers la cause populaire, germe qu’il convient donc de contenir grâce à des institutions tutélaires qui soutiennent cette cause et y puisent réciproquement leur force. Mise à part la liberté de la presse, trois choses sont indispensables pour garantir la perfection progressive des institutions et éviter les trahisons et les manipulations qui ont à deux reprises anéanti la constitution de 1812. Ces trois choses sont : les sociétés patriotiques, une autorité conservatrice des institutions politiques et une imitation du système fédéral. Nous développerons succinctement ces trois points.
Toute action officielle, quand bien même elle émanerait de la délégation populaire, revêt un caractère différent de l’action spontanée des citoyens. La première, même si on lui prête une bonne intention, la plupart du temps n’avance pas ou demeure inefficace quand elle ne reçoit pas l’impulsion et le soutien de la seconde. En Angleterre, l’action spontanée des citoyens s’exerce au sein de réunions populaires initiées par un député ou un groupe d’électeurs, ou par une corporation industrielle, ou encore par l’un des innombrables clubs ou sociétés qui, lorsqu’elles revêtent un caractère politique, méritent le nom de patriotiques. En Espagne, les sociétés patriotiques formées naturellement par association de quelques hommes instruits, à l’instar des clubs anglais et français, préparent les travaux et donneront l’impulsion pour que soient convoquées des réunions populaires en respectant les formalités prescrites par les lois. Nous avons entendu plusieurs objections concernant ces institutions, mais nous aurons peu de chose à ajouter aux plaidoyers du sage Marina, du distingué patriote San Miguel et d’autres hommes illustres. Il nous suffirait d’écouter l’opinion de ces messieurs, et l’opinion contraire des Martinez de la Rosa, Garelis, Moscosos et Torenos, pour comprendre que les sociétés patriotiques encombrent le despotisme et favorisent la liberté.
L’institution d’un Sénat conservateur réside dans la nécessité de compter avec un corps qui soit suffisamment éloigné des multiples intérêts et conflits[11] qui assaillent les pouvoirs législatif et exécutif afin de conserver une meilleure sérénité d’esprit pour observer et se prononcer sans autre motivation que celle de la patrie et de l’honneur. Placé à une certaine distance des événements, les jugeant dans leur ensemble et sans être distrait par les tâches quotidiennes et la gestion de questions ponctuelles, le Sénat conservateur sera mieux à même de connaître l’état général de la nation et de deviner l’imminence d’un danger que les autres méconnaissent ou s’obstinent à nier. Ce danger peut même provenir des pouvoirs constitués. Il peut par ailleurs éclater entre eux des différends désagréables sur les limites de leurs facultés qui ne justifient pas un recours à la nation en masse, mais qui peuvent dégénérer en maux difficilement réparables s’ils ne sont pas réglés.
Les fonctions de ce corps, pour des raisons inhérentes à son institution, ne doivent pas s’exercer sur des affaires précises, mais seulement sur les fondements constitutionnels, parmi lesquels se trouve le pouvoir de déclarer la patrie en danger. Les affaires courantes ne seront pas non plus de son ressort. Il ne s’occupera que du fonctionnement général de la société et des situations extraordinaires et de grande transcendance. Il ne faut pas confondre le Sénat conservateur avec un tribunal ou une corporation destinée à réprimer des infractions ordinaires à la constitution que l’autorité du congrès ou du gouvernement suffit à corriger[12].
Nous ne prétendons pas que le Sénat conservateur soit irresponsable ni inamovible. Sans entrer ici dans les détails, précisons seulement que son élection doit se faire par le biais d’assemblées territoriales, dont nous parlerons plus loin, et avec des garanties de participation populaire.
Nous devons nous expliquer sur l’introduction de l’élément fédératif en Espagne. Dans un pays aussi fermé, il ne faut pas craindre la perte du principe de l’unité nationale. Les juntes de gouvernement des provinces, qui ont surgi lors de toutes les grandes crises politiques, n’ont jamais cessé de reconnaître le lien qui unit tous les membres de la famille espagnole. La situation de la Péninsule, située à une extrémité de l’Europe, la préserve en outre des dangers d’une position plus centrale qui, comme en France, justifierait une grande concentration de forces face à la possibilité d’une agression étrangère. Il est vrai que nous parlons toujours de la Péninsule comme si tous ses peuples étaient unis. Nous sommes pourtant convaincus que cela ne tardera pas à arriver et que, malgré les obstacles que posent ici comme ailleurs les différentes dynasties, c’est justement le fédéralisme qui aplanira le chemin en faveur de cette réunion. Les dynasties sont au service des peuples et non les peuples au service des dynasties. Nous ne comprenons pas sur quoi pourrait se fonder le droit d’en conserver deux là où une seule suffit voire où aucune n’est nécessaire. Le système fédéral, étranger à toute idée de conquête ou de supériorité et, au contraire, fondé sur l’égalité politique entre les états fédérés, est le seul en mesure de procurer bien et vite la réunion des deux peuples péninsulaires sous un seul gouvernement. Le principe d’unité étant assuré par la position géographique de la Péninsule, c’est un devoir de profiter des avantages d’un système fédéral également favorisé par les reliefs de l’intérieur du pays. Deux avantages principaux. Le premier est que le gouvernement central, dégagé d’une infinité de tâches minutieuses et concentré sur quelques fonctions simples et générales, ne peut pas exercer ce despotisme impertinent qui consiste à vouloir tout couler dans le même moule et à imposer aux différentes localités un modèle inventé dans la capitale. Il ne peut pas non plus concentrer entre ses mains tant de faste et de corruption. Il ne sera par conséquent pas aussi onéreux qu’un gouvernement centralisé. Le deuxième et principal avantage est que les provinces disposeront d’un germe propre de vie et d’activité qui donnera un élan puissant à leur prospérité et à leur civilisation et qui les préservera de toutes les conséquences néfastes de la corruption du gouvernement central. Et si la liberté s’installe dans la capitale, elle trouvera asile et préparera sa résurrection dans les provinces. La nature elle-même semble proposer ce moyen aux habitants de la Péninsule. Dans quel autre pays trouverons-nous des portions de territoire si bien caractérisées et circonscrites, des barrières si nettes pour la défense comme celles que l’on trouve en Andalousie, en Galicie, au Portugal, etc. ? L’histoire nous enseigne en même temps qu’il est pertinent de respecter les particularités des provinces et qu’il est difficile de les agresser. Peut-être devons-nous puiser dans l’esprit provincial la dernière espérance de régénération de l’Espagne. Car, si l’air de la cour a asphyxié ceux qui s’arrogent le droit de représenter la nation, le cri de liberté sortira peut-être d’une province. Espérons que la révolution ne reniera alors pas le principe qui lui a donné la vie, qu’elle ne se laissera pas museler ni corrompre par les manœuvres de la capitale qui ont plus d’une fois conduit la nation à sa perte. Au moment où nous écrivons ces lignes, nous sommes témoins d’un exemple scandaleux de la vitesse à laquelle les meilleures dispositions se trouvent perverties lorsque leur direction est concentrée et que la force est confiée à une poignée d’oligarques. Ces derniers, parce qu’ils sont plus riches que la masse du peuple, pensent que tout doit se résoudre dans leur propre intérêt, et qu’ils sont la patrie et la nation.
Nous n’avons pas l’intention d’expliquer toutes les combinaisons du système fédéral, les plus fines et sublimes de l’organisation sociale. Il suffit d’introduire dans la constitution de 1812, notre point de départ, un élément fédéral qui pourra au fil du temps se développer jusqu’à atteindre la perfection. Nous sommes convaincus que les députations provinciales établies par la constitution pourraient à certaines périodes se réunir en assemblées territoriales pour traiter les affaires qui présentent un intérêt commun à une circonscription déterminée par les configurations topographiques de la Péninsule. Sans entrer pour l’heure dans des démonstrations plus circonstanciées, il nous semble que les capitaineries générales pourraient, en les adaptant un peu, servir de base pour mettre en place ces divisions fédérales. Rien ne s’oppose non plus à ce que dans certaines circonstances, par exemple si la défense du pays l’exige, on réunisse deux ou trois assemblées territoriales.
Il n’est pas facile de donner une idée claire des fonctions de ces assemblées fédérales. Seuls le temps et l’expérience pourront réaliser la délégation progressive des attributions du gouvernement central et ramener peu à peu toutes les autorités publiques dans leur vrai cercle.
Pour le reste, ne croyez pas que les difficultés à mettre en place ce système émanent de sa nature. Elles proviennent de nos préoccupations. Nous pouvons déjà nous inspirer de l’exemple des États-Unis où tous les ressorts du régime politique se meuvent avec la plus grande aisance et au moindre coût. Engageons-nous de bonne foi sur le sentier des réformes et celui-ci nous conduira au terme souhaité.
Il nous reste encore à dire quelques mots de la Garde nationale. Dans sa bonne organisation réside la clé des institutions politiques et la garantie que la force est reliée au droit et que par conséquent, tant que la nation n’est pas viciée, ses institutions seront indestructibles. Car la première conséquence de la souveraineté du peuple est que tout le peuple sera armé en Garde nationale. Si l’ensemble du peuple ou du moins l’immense majorité est animée du même esprit, comment pourra-t-on lui soustraire les institutions qu’il défend ? Il est vrai qu’en donnant des armes aux volontaires réalistes on a été confronté à la plus grande absurdité avec un peuple armé pour défendre le despotisme. Mais les circonstances ont beaucoup changé et l’on peut dire que lorsque l’esprit du gouvernement est libéral, dans l’état actuel des nations civilisées d’Europe, l’amour de la patrie et les ressorts de ce que l’on appelle esprit de corps suffisent à entraîner la majorité de ceux qui en d’autres temps se prêtaient aux manigances du despotisme. Nous considérons alors sans fondement le prétexte avancé par les ministres de prendre le Statut royal comme règlement, leur vrai objectif étant d’aristocratiser cette institution, en la fractionnant et en la circonscrivant aux classes qu’ils supposent les plus facilement intéressées à défendre le juste milieu. Un gouvernement libéral trouverait vite le moyen de s’entourer de trois cent mille citoyens dont l’enrôlement volontaire serait une garantie de leur mode de pensée. Dans cette milice volontaire pourraient être admis les fils de famille à partir de 18 ans qui, au bout de deux ans de service, auraient les mêmes droits que des chefs de famille (domiciliados). Le reste serait du ressort des députations et des conseils municipaux, à qui il conviendrait en un premier temps de laisser prendre les dispositions relatives à l’enrôlement et au service. Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce sujet, car nous sommes persuadés que la plupart des fonctions du régime social peuvent être rassemblées dans l’action politique de la Garde nationale. Nous ferons sans doute connaître un jour l’organisation qui nous semble la mieux adaptée.
Cette organisation facilitera beaucoup les élections. Nous croyons que le mode d’élection avec trois niveaux – paroisses, cantons et provinces – indiqué dans la constitution, ne devra pas subsister, car il s’agit d’une fiction représentative trop métaphorique qui ne nous semble plus pertinente. Il sera désormais nécessaire que ce soient les électeurs de canton qui, réunis dans la capitale de la province ou dans le lieu le plus central de celle-ci, nomment les députés aux Cortès afin d’éviter la concentration des votes sur peu de personnes. Avec cette nouvelle disposition, l’élection des députés sera plus directe et plus populaire. Des hommes sans aucun mérite ne pourront plus être élus par le biais d’intrigues. C’est ce qui par malheur se produit aujourd’hui, et nous n’aurions aucune difficulté à désigner quatre individus dans une seule province.
Une fois adopté le système d’élection que nous prônons, à savoir que les électeurs de canton nomment successivement les députés aux Cortès, les députations provinciales influenceront l’élection, car nous pensons que c’est à elles que revient la mission de préparer l’opinion, en débattant des intérêts du moment et en désignant les personnes qui, de par leurs antécédents, semblent réunir les meilleurs titres pour mériter la confiance publique. Les citoyens auraient alors le champ libre pour s’informer et confronter les propositions de la députation provinciale. La publicité des débats, qui ne pourrait que favoriser l’esprit national et la morale des citoyens, précéderait d’un mois ou deux la période des réunions des juntes paroissiales.
Si la liberté était assurée de toutes les garanties que nous avons mentionnées – déclaration populaire des principes ; une bonne constitution ; participation spontanée de l’opinion dans les associations ; protection des libertés individuelles par les représentants du commun (sindicos personeros) ; garantie de la participation locale dans les assemblées territoriales, un contrôle désintéressé du fonctionnement général de la société par le Sénat conservateur et le soutien de la Garde nationale –, quel parti avec une once de raison pourrait s’opposer à un système si bénéfique ? Prenons le cas de cette guerre civile qui détruit notre beau pays : si l’on voulait supposer que les Navarrais et les Bizcayens se battent pour leurs privilèges, on leur reconnaîtrait bien plus que leurs privilèges, et l’introduction des assemblées territoriales permettrait de satisfaire les exigences provinciales. Mais si cela ne suffisait pas à les calmer, leur mauvaise foi serait si manifeste et la réaction du reste de la nation si imposante que les mesures les plus rapides et terribles seraient justifiées et faciles à mettre à exécution. L’occupation militaire avec 150 000 hommes du pays insurgé et la déportation de la population carliste à d’autres provinces nous semble préférable à une lutte interminable dans laquelle se perd tout sentiment humain. Les habitudes contractées dans une telle guerre transformeront les vainqueurs et les vaincus en objets d’horreur et d’épouvante que la nation ne pourra pas contempler sans faire de sinistres présages et sans chercher les moyens de se libérer de cette nouvelle plaie morale.
Misérables peuples, misérables Espagnols, vous ne savez pas prononcer la voix de la liberté, si toutefois elle sort de votre bouche, sans lui accoler un nom qui lui soit blasphématoire ! Vos idoles vous ont-elles fait tant de bien que vous ne vous lassez pas de chercher anxieusement de nouvelles idoles ? Comme ils ont bien répondu à vos aspirations vos grands, vos immortels, vos désirés, vos bien-aimés ! Voyez comme ils dévorent vos meilleurs enfants, comme ils rabaissent et avilissent les meilleures réputations à leur seul contact ! Qu’est-il advenu de vos Martinez de la Rosa, de vos Torenos, de vos fondateurs et législateurs constitutionnels ? Voyez-les se traîner dans la fange de l’adulation, du sybaritisme, d’une condescendance servile. Voyez-les se triturant les méninges, non pas pour voir comment vous procurer davantage de liberté et de plaisirs, sinon comment lever des barrières pour défendre les trônes, comment rogner vos droits, comment mériter au mieux le titre de fidèles serviteurs de la cour en reniant leurs anciennes convictions, comment vous faire supporter toutes les charges pour complaire à tous les Rois de l’univers. Et qui les a pervertis ? Auraient-ils osé se montrer sous un jour si laid et dégoûtant s’il n’avait pas existé des noms propres qui gobent tout, s’il n’y avait qu’un peuple espagnol ? À présent, on vous leurre avec la promesse de davantage de liberté lorsque, à force de sang versé et de sacrifices, vous aurez exterminé les uns et laissé le champ libre aux autres. Auriez-vous confiance en des promesses qui ont moins de valeur que de la fausse monnaie ? Qui est censé vous donner la liberté ? Seront-ce ces rois qui, parmi tous les conseillers, choisissent toujours les pires et qui, parmi tous les ministres, choisissent toujours les plus serviles ? Seront-ce ces procureurs qui vous ont procuré le plaisir de payer vos chaînes[13], qui ont perdu toutes les occasions de vous rendre plus libres, qui ont le talent particulier d’être serviles y compris lorsqu’ils font un effort pour se montrer libéraux[14] ? Des hommes couards et incapables qui, n’ayant pas même su affronter le misérable ministère qui les dirige[15], trembleraient face à un trône victorieux ? Ce que vous avez obtenu jusqu’à présent, comment l’avez-vous obtenu ? Par la force ! Et ce n’est que par la force que vous obtiendrez dorénavant quelque chose. Nous le prédisons et le temps en sera témoin : chaque pas vous coûtera une sédition, une démonstration violente. Et soyez reconnaissants si, vaincus, vous ne perdez pas en un jour le fruit de tant d’efforts.
La constitution ou l’esclavage ! Pas d’autre alternative. La souveraineté du peuple ! La liberté ou la mort ! sera votre cri. Braves soldats d’Aragon, vous qui êtes rompus à la rigueur de la discipline militaire, vous auriez dû apprendre aux citoyens à être libres, car ils ne l’ont pas encore appris ! Braves officiers subalternes, vous faites pour la patrie ce que l’orgueil aristocratique interdit à vos chefs. Vous avez acclamé la liberté, mais à peine vos chefs vous ont-ils eu à leur disposition qu’ils se sont précipités pour acclamer en votre nom le Statut royal.
Des ministres renégats de la cause de la liberté, des représentants qui ne représentent rien, des comédiens portant le manteau d’hermine vous accusent d’être anarchistes ! De quel droit ? Que défendent-ils, eux ? Qu’avez-vous préconisé, vous ? Qui sont les anarchistes ? Ceux qui revendiquent une constitution légitime, reconnue, ratifiée par toute la nation, y compris par les renégats, et qui a été suspendue par ces derniers, par un tyran traître et par les baïonnettes étrangères ? Ou ceux qui ont lancé sur le peuple cette nouvelle pomme de discorde en forgeant ce Statut qui, loin d’être un guide pour gouverner, ne sert qu’à installer la mésentente entre gouverneurs et gouvernés. Comment peuvent-ils parler d’anarchie alors que ce sont eux qui ont donné le premier exemple d’anarchie en reniant leurs serments ? Ils se retrancheront derrière l’autorité de la nation puisqu’ils sont les fils de Ferdinand et de ses conseils municipaux. D’ailleurs on reconnaît leur origine à travers leurs agissements : ils ne concèdent à la nation que la permission de verser son sang et de sacrifier le fruit de ses sueurs. Car aucun procureur de la nation, à travers cette mascarade de la session permanente rapiécée à la hâte, n’a eu assez de probité et de valeur pour reconnaître la vraie cause de l’exaspération publique au lieu de recourir au fantasme de l’intervention étrangère dans le seul but de jouer à moindre frais le rôle de patriote et de détourner l’attention du public de ses vraies motivations. Et comment s’est conclue cette mascarade ? Avec le même ridicule que tout le reste. Un député propose que l’on demande humblement au gouvernement (demander, quelle honte !) qu’il permette d’ériger un édifice sur les fondations du Statut. L’idée de faire un message est acceptée, mais comment s’exécute-t-elle ? Dans le sens opposé, en approuvant la conduite du gouvernement[16].
« Les débats parlementaires ne sont qu’un appât pour duper le peuple au profit des rois » : tel est le jugement que porte un quotidien à l’égard de cette session et qui fait frémir par sa vérité crue. Ce même quotidien avait soutenu que l’insurrection de Madrid n’a été qu’une tentative ratée à cause de l’opposition, et qu’il sera nécessaire de l’entreprendre à nouveau, mais que les partisans du progrès se garderont bien alors de compter sur un soutien si fragile.
Nous ne savons pas ce qu’il adviendra, mais nous le répétons une fois de plus : le gouvernement et les pitoyables chambres, en s’obstinant à agir de fait et non de droit, ont entraîné les citoyens à agir de la même façon et à leur demander des comptes le jour où ils prendront conscience de leur force pour faire valoir leur droit.
Nous venons d’apprendre la trahison des patriotes du 18 janvier. Si du sang doit couler, qu’il tombe sur la tête du perfide qui le fait couler.
[1] Ces gouvernements constitutionnels parlent d’anarchie. Mais, lorsqu’on examine ce qu’ils entendent par anarchie, on voit qu’il s’agit en réalité des actes les plus élémentaires de l’intervention populaire.
[2] C’est ce qui advient lorsqu’on dit que les citoyens seront égaux devant la loi, mais qu’on ne garantit pas que la loi sera égale pour tous les citoyens. Il ne suffit pas non plus que tous puissent monopoliser, il faut plutôt qu’il n’y ait pas de monopole.
[3] Les quotidiens anglais, lors des élections de cette époque, ont présenté un tableau du rapport moralité/richesse qui établit que plus on a de rentes, plus on est conservateur et, inversement, que moins on a de rentes, plus on a tendance à épouser le mouvement.
[4] Nous ne parlons pas du Statut royal, la plus infime de toutes les combinaisons qui se prétendent constitutionnelles, une vraie injure à la nation. Car, au fond, ce n’est que cogitations d’avocat qui émanent du pouvoir absolu, dans le but de réduire à la plus petite expression un fait que l’on ne pouvait plus éviter. Son titre même est une absurdité : pourquoi ne s’appelle-t-il pas Statut national ? Les rois ont-ils le droit de statuer sur les nations ?
[5] L’Aragon a connu une espèce de tribunat en la personne du magistrat suprême. Le peuple, contrairement à son devoir, ne l’a pas défendu contre les turpitudes de Felipe II, et le tribunat a expiré avec le martyre du dernier qui l’a exercé.
[6] Que les Députés du peuple représentent le progrès et que les députés de leur caste ou de la cour qui les nomme représentent la résistance est désormais un axiome. Pourquoi ne pas laisser alors le progrès cheminer tout seul ?
[7] Il est pertinent ici de se remémorer un paragraphe du discours du comte de Navas sur la non-attribution d’une part du budget au prince Sébastien parce qu’il n’avait pas juré fidélité à la Reine : « L’obligation de jurer fidélité aux rois et de les servir loyalement est en lien direct avec le rang occupé dans la hiérarchie sociale. » Ici l’on remarque des choses étranges : 1° l’on jure fidélité et l’on est au service non pas de la nation sinon des rois ; 2° il y a une superposition de hiérarchies partant du peuple jusqu’au trône, et que celles qui sont le plus près du trône ont une obligation plus étroite envers celui-ci. Ce que Monsieur le comte semble ne pas voir, c’est que cela ne pourrait advenir que si le trône possédait un droit distinct de celui de la nation car, autrement, le serment de fidélité au roi n’est qu’un serment de fidélité au délégué de la nation. Or, , envers la nation, tous ont la même obligation comme ils ont les mêmes droits : le prince Sébastien ne vaut pas plus que le producteur de melons ou le pêcheur de sardines. Quand un défenseur du libéralisme parle en ces termes, que peut-on espérer des autres ? Doit-on admirer qu’une chambre de notables soit tolérée et qu’on la considère encore comme une invention héroïque ?
[8] La monarchie coûte aux Espagnols à ce jour 40 millions en liste civile, 200 millions en guerre civile et plus de 2 000 millions de dette royale.
[9] Qui ignore que l’illustre Porlier était le beau-frère de Toreno et que le fameux Riego était le neveu de Cayetano Valdes ?
[10] Nous avons vu de nombreuses lettres d’Espagne pleines de gémissements sur le sort du pays. Mais pourquoi le pays n’arrête-t-il pas de gémir et de pleurer ? Nous ne pouvons attribuer ce phénomène qu’à un défaut d’organisation des patriotes, à moins que ce ne soit la tyrannie de Ferdinand qui ait réussi à étouffer le dernier souffle de l’énergie espagnole, autrefois si redoutable.
[11] C’est la raison pour laquelle on ne croit pas qu’il soit pertinent d’attribuer au Sénat conservateur des fonctions judiciaires.
[12] Nous ajouterions aussi aux députations provinciales l’introduction d’un syndic dont l’objet précis serait de contrôler le rigoureux respect des garanties établies par la constitution en faveur des quatre libertés mentionnées dans l’article 7 de la déclaration de principes.
[13] Il est vrai que par ce moyen l’Espagne a, parallèlement à une dette indéfinie, gagné le jeu débridé de la Bourse, qui est le ressort souverain de ce juste milieu qui enfouit tout dans la fange de la corruption. Toutes ces danses, tout ce luxe et tous ces paris en Bourse, ce sont leurs plaisirs, leurs moyens de se procurer l’argent et c’est ainsi que se fait la guerre au patriotisme, en étouffant tout sentiment de générosité.
[14] En attestent les sessions où l’on a parlé du bataillon d’Aragon.
[15] Il n’y a pas d’insolence que ne s’autorisent les ministres et que ne souffrent lesdits procureurs. Le ministre leur dit que s’ils ne veulent pas de censure, il la remplacera par le timbre ; que s’ils ne veulent pas financer les infamies de la police secrète, il les financera lui-même. Et eux restent muets. On le voit bien, s’il n’y avait pas d’entrave à la pensée et une police pour surveiller les patriotes, comment un tel ministère et une telle chambre pourraient-ils exister ! Ce n’est qu’ainsi que pouvait être inventé le système de perpétuité ministérielle malgré des élections perdues, un système qui semble avoir inspiré les ministres doctrinaires français et les ministres tories anglais. On pourrait au contraire imiter en Espagne le charivari qu’on oppose aux représentants français à qui on colle dans le dos un écriteau qui dit « Ceci est un député, il est interdit sous peine d’amende d’y jeter les ordures ».
[16] Et, lors de ce débat, ces ministres se sont orgueilleusement targués d’être les amis d’une liberté modérée ? Mais il y a un avantage à cela : dans ces bouches est mise en évidence toute l’absurdité de cette expression. Que signifie liberté modérée ? La liberté est totale ou elle est nulle. Lorsque l’on veut fixer le point de départ de l’anarchie, il faut prouver qu’une certaine manière d’exercer la liberté est incompatible avec l’existence sociale. Mais cette preuve ne peut s’obtenir qu’avec le concours de la nation. Les dires d’une poignée d’oligarques cramponnés à un brouillon qui leur garantit à eux seuls les jouissances de la société, reportant sur la grande masse les labeurs et les sacrifices, ne peuvent suffire. Chaque fois que l’on pense aux Petits tyrans qui oppriment l’Espagne, cette expression nous suggère deux personnages connus que l’on imagine embourbés dans leurs comptes et leurs contes, encerclés par des chiens et des chiennes, plus insatiables les uns que les autres… Et c’est à ce régime que rendent hommage les hommes d’Espagne.
Bibliographie
Isabel Burdiel y María Cruz Romeo, “Viejo y nuevo liberalismo en el proceso revolucionario, 1808-1844”, in Paul Preston et Ismael Saz, (dir.), De la revolución liberal a la democracia parlamentaria. Valencia (1808-1975), Madrid-Valencia, Biblioteca Nueva, 2001, p. 75-92.
Ana M. García Rovira, La revolució liberal a Espanya i les classes populars (1832-1835, Vic, Eumo, 1989.
Ana M. García Rovira, “Radicalismo liberal, republicanismo y revolución (1835-1837)”, Ayer, 1998, nº 29, p. 63-90.
Ana M. García Rovira, “Sociedades secretas, facciones y partidos políticos durante la Revolución Liberal: la Barcelona revolucionaria (1835-1837)”, Trienio, 1998, nº 32, p. 67-102.
Florencia Peyrou, Tribunos del pueblo. Demócratas y republicanos en el periodo isabelino, Madrid, CEPC, 2008.
Florencia Peyrou, “Los orígenes del federalismo en España: del liberalismo al republicanismo, 1808-1868”, Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea, 2010, n° 22, p. 257-278.
María Cruz Romeo, Entre el orden y la revolución. La formación de la burguesía liberal en la crisis de la monarquía absoluta (1814-1833), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 1993.
María Cruz Romeo, “La sombra del pasado y la expectativa de futuro: “jacobinos”, radicales y republicanos en la revolución liberal”, in Lluis Roura et Irene Castells, Revolución y democracia. El jacobinismo europeo, Madrid, Ed. del Orto, 1995, p. 107-138.
María Cruz Romeo, “Lenguaje y política del nuevo liberalismo: moderados y progresistas, 1834-1845”, Ayer, 1998, n° 29, p. 37-62.
Pierre Rosanvallon, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimard, 1992.
Joaquín Varela Suanzes, La Teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), Madrid, CEPC, 1983.
Joaquín Varela Suanzes, “La Constitución de Cádiz y el liberalismo español del siglo XIX”, Revista de las Cortes generales, 1987, nº 10, p. 27-109.
Joaquín Varela Suanzes, “El pensamiento constitucional español en el exilio: el abandono del modelo doceañista (1823-1833)”, Revista de Estudios Políticos, 1995, nº 88, p. 63-90.

Pour citer ce document
Pedro Méndez Vigo, Garanties de la nation espagnole, [Paris, 1835], présenté par Florencia Peyrou et traduit par Alexandre Frondizi, dans Olivier Christin et Alexandre Frondizi (dir.), Bibliothèque numérique du projet Républicanismes méridionaux, UniNe/FNS, 3 avril 2021, URL : https://unine.ch/republicanism/home/bibnum/catechismes/11.html


